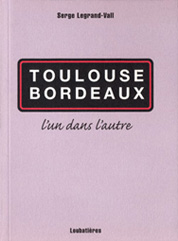L’histoire de ce roman a commencé le jour où je suis entré dans l’ancienne maison de vacances de Victor Duruy, homme politique et historien du XIXe siècle. Cette demeure dominant la vallée de la Dordogne appartenait toujours à ses descendants et la volumineuse bibliothèque de l’ancêtre ne semblait pas avoir bougé. En observant avec curiosité les ouvrages, un petit livre attira mon attention. Écrit par un missionnaire en 1843, il exposait les mésaventures de deux évangélisateurs, envoyés dans l’île Marquisienne de Tahuata, en plein océan Pacifique, et livrés à eux-mêmes au milieu de naturels plutôt rugueux et sourds à la parole du Dieu venu de France.
Une carte de l’archipel était jointe à l’ouvrage. Je fus très surpris de découvrir que le bras de mer séparant les îles d’Hiva-Oa et de Tahuata y était désigné sous le nom de Canal du Bordelais. Un bateau en provenance de Bordeaux avait donc en ce milieu XIXe touché ces côtes peu visitées et laissé sa trace en baptisant un lieu ?
Suite à la publication d’un essai, Toulouse Bordeaux l’un dans l’autre, dans lequel j’évoquais cette curiosité, un lecteur bordelais très au fait de l’histoire maritime de la ville a tenu à éclairer ma lanterne.
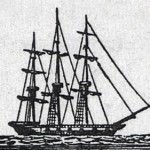 Dans son courrier, il me livra le début de l’explication : Entre 1816 et 1819, un capitaine de la marine royale du nom de Camille de Roquefeuil avait effectué pour l’armateur bordelais Jean Étienne Balguerie un tour du monde sur le trois-mâts marchand Le Bordelais. Voyage au cours duquel il avait fait escale aux Marquises, baptisant un Canal du Bordelais et un Cap Balguerie. Rentré au pays après trente-sept mois et deux jours de mer, le capitaine français avait même publié un ouvrage relatant son épopée.
Dans son courrier, il me livra le début de l’explication : Entre 1816 et 1819, un capitaine de la marine royale du nom de Camille de Roquefeuil avait effectué pour l’armateur bordelais Jean Étienne Balguerie un tour du monde sur le trois-mâts marchand Le Bordelais. Voyage au cours duquel il avait fait escale aux Marquises, baptisant un Canal du Bordelais et un Cap Balguerie. Rentré au pays après trente-sept mois et deux jours de mer, le capitaine français avait même publié un ouvrage relatant son épopée.
Mis en appétit par cette révélation, je me mis en quête du livre en question. Si un exemplaire de l’édition originale de 1823 se révéla introuvable, j’eus une fois encore la bonne surprise d’apprendre qu’un auteur du nom de René Cruchet avait publié en 1952 à Bordeaux un ouvrage qui rappelait à ses contemporains ce haut fait de l’histoire maritime. Des extraits du livre de Roquefeuil assortis des commentaires de l’auteur firent toute la lumière sur les circonstances et les buts de cette unique circumnavigation de l’histoire effectuée par un trois-mâts marchand parti de Bordeaux.
En 1816, La France de la restauration, ruinée par les guerres napoléoniennes, était en manque de liquidités pour l’importation de marchandises. L’idée de l’armateur Jean Étienne Balguerie fut d’aller prospecter sur la côte ouest du continent américain, à la recherche d’un fret avantageux à troquer contre des marchandises européennes de faible valeur. Ce fret devait ensuite être échangé dans les ports chinois contre du thé et des porcelaines qui seraient revendus avec profit en Europe.
 Immobilisé par l’hiver devant Vancouver sans avoir trouvé le fret espéré, le capitaine décida d’aller passer la mauvaise saison sous des latitudes plus clémentes et relâcha deux mois aux îles Marquises. Attirés par leur richesse en bois de santal, les premiers navires marchands américains y faisaient alors escale, et quelques aventuriers des mers avaient élu domicile parmi ses farouches tribus. Roquefeuil noua des relations amicales avec les insulaires et repartit avec vingt et une tonnes de santal qu’il avait échangé contre de la poudre et des fusils.
Immobilisé par l’hiver devant Vancouver sans avoir trouvé le fret espéré, le capitaine décida d’aller passer la mauvaise saison sous des latitudes plus clémentes et relâcha deux mois aux îles Marquises. Attirés par leur richesse en bois de santal, les premiers navires marchands américains y faisaient alors escale, et quelques aventuriers des mers avaient élu domicile parmi ses farouches tribus. Roquefeuil noua des relations amicales avec les insulaires et repartit avec vingt et une tonnes de santal qu’il avait échangé contre de la poudre et des fusils.
L’escale du Bordelais s’inscrit dans le contexte du développement de l’exploitation des ressources de l’océan Pacifique par les nations d’Europe et d’Amérique du Nord au début du XIXe siècle.
 À l’arrivée du Bordelais, en décembre 1817, l’archipel isolé des Marquises n’avait reçu que très peu de visites des Européens et faisait figure d’Eden. Comme dans le reste du monde polynésien, les insulaires avaient construit un système social et religieux complexe. Depuis le voyage de Bougainville à Tahiti, le mode de vie Maori, fait d’indolence et de lascivité, mais qui incluait le cannibalisme, fascinait l’occident. L’introduction de l’alcool et des armes à feu par les navires baleiniers et santaliers mais aussi l’apparition de maladies inconnues et mortelles se révélèrent désastreuses pour les indigènes. Avant l’arrivée des Européens, on estimait la population de l’archipel à cinquante mille personnes. À partir de 1842, année de la prise de possession de ces îles pour la France par l’amiral Dupetit-Thouars et du séjour à Nuku-Hiva d’Herman Melville, la mortalité prit des proportions dramatiques. L’auteur Jean-Louis Teuruarii Candelot parle de cataclysme pour qualifier les effets sur le peuple marquisien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Sous les actions conjuguées des navires de passage, de l’administration française et des missionnaires, la civilisation marquisienne s’effondra et la population passa près de la disparition, puisqu’il ne restait dans tout l’archipel qu’un peu plus de deux mille personnes en 1926.
À l’arrivée du Bordelais, en décembre 1817, l’archipel isolé des Marquises n’avait reçu que très peu de visites des Européens et faisait figure d’Eden. Comme dans le reste du monde polynésien, les insulaires avaient construit un système social et religieux complexe. Depuis le voyage de Bougainville à Tahiti, le mode de vie Maori, fait d’indolence et de lascivité, mais qui incluait le cannibalisme, fascinait l’occident. L’introduction de l’alcool et des armes à feu par les navires baleiniers et santaliers mais aussi l’apparition de maladies inconnues et mortelles se révélèrent désastreuses pour les indigènes. Avant l’arrivée des Européens, on estimait la population de l’archipel à cinquante mille personnes. À partir de 1842, année de la prise de possession de ces îles pour la France par l’amiral Dupetit-Thouars et du séjour à Nuku-Hiva d’Herman Melville, la mortalité prit des proportions dramatiques. L’auteur Jean-Louis Teuruarii Candelot parle de cataclysme pour qualifier les effets sur le peuple marquisien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Sous les actions conjuguées des navires de passage, de l’administration française et des missionnaires, la civilisation marquisienne s’effondra et la population passa près de la disparition, puisqu’il ne restait dans tout l’archipel qu’un peu plus de deux mille personnes en 1926.
Le tour du monde du Bordelais ne fut pas une réussite commerciale et les armateurs du port de la lune ne donnèrent aucune suite à ce voyage exploratoire qui fut rapidement oublié. Il reste dans le récit du Capitaine de Roquefeuil l’éblouissement de l’équipage pour la beauté de ces îles et la douceur de leurs habitants.
Siepky, marin engagé à Bordeaux pour sa connaissance des mers du sud et promu officier pendant le voyage, s’est rapidement imposé à moi comme le personnage clé du roman. Le mystère même qui lui est attaché le rendait idéal pour rassembler l’histoire et la fiction.


 janvier 15th, 2010
janvier 15th, 2010  Serge Legrand-Vall
Serge Legrand-Vall